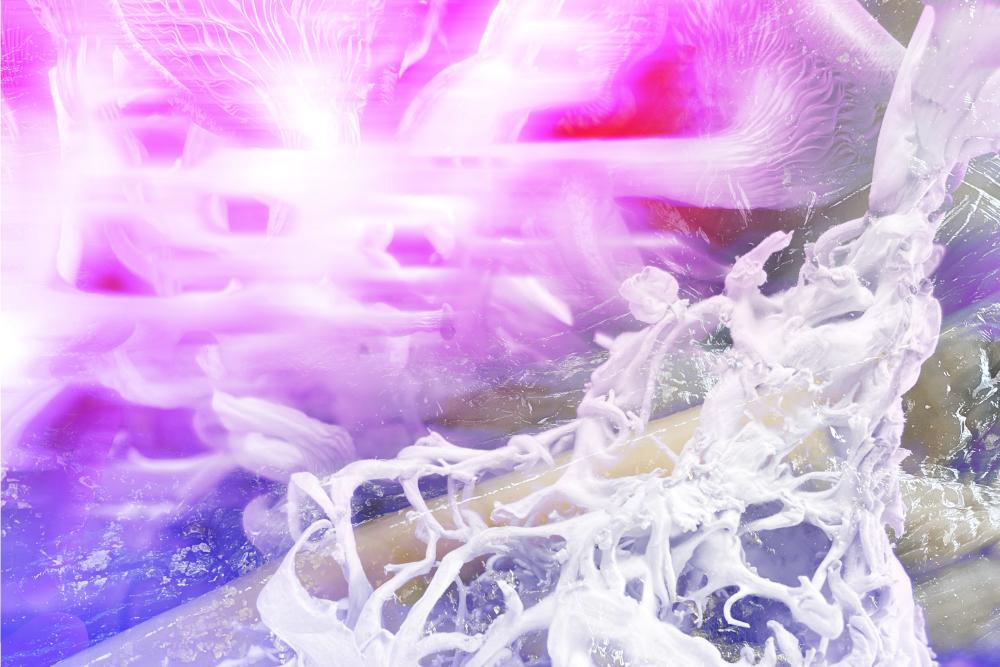MOLD
Ici vous trouvez une description courte du spectacle et la distribution.
Entre la fermentation sauvage et les scultpure
Entretien avec Sara Manente par Wilson Le Personnic. (MaCulture.fr, 09/08/2022)
Comment transposer les principes de contamination et de connexion des microorganismes (bactéries, levures et moisissures) à l’échelle de la danse et du corps ? Puisant dans la biologie, la mode, la danse ou encore les arts visuels, Sara Manente développe aujourd’hui une recherche à l’intersection des arts vivants et de la mycologie. Inspirée des processus de fermentation et des méthodes de culture de mycélium, sa dernière création MOLD aborde la performance comme un environnement immersif où chaque corps et objets qui la compose s’affecte et interagissent comme des cultures vivantes. Dans cet entretien, Sara Manente partage les rouages de sa recherche artistique et revient sur le processus de recherche de MOLD.
Vos recherches semblent se matérialiser différemment selon chaque projet. Comment décririez-vous votre recherche/travail artistique ?
Partant de la danse comme pratique et outil de réflexion, mes projets de recherche s’intéressent aux différentes manières de se produire, d’être produit et d’être public. Depuis quelques années, j’utilise l’idée de la publication performative pour envisager les moyens de « rendre public ». En pensant de manière analogique, non numérique, non binaire, nous pouvons établir différents degrés entre, disons, la publication sur papier et la performance sur scène, ce qui signifie différentes manières d’aborder les questions du public et de performativité. Pour MOLD, ma plus récente performance de danse, le travail s’est développé à partir de mes recherches précédentes sur la fermentation et s’est ramifié en différents gestes performatifs, tous appelés MOLDING, et une école ouverte appelée Technologie des champignons. Pour la recherche Wicked Technology/Wild Fermentation (2019-2020), j’ai publié ROT, un magazine sur papier glacé et j’ai organisé un programme de trois jours appelé ROT GARDEN. Pour Spectacles (2014-2018), j’ai écrit trois danses à lire et réalisé un film 3D en collaboration avec Christophe Albertijn. Avant ces projets, je n’utilisais pas la même terminologie. Je parlais de la relation entre le·la danseur·euse, le·la chorégraphe, l’œuvre et le public, en la considérant comme une interaction dynamique où la performance se produit réellement. Dans Tele Visions (2016-2018), une collaboration avec Marcos Simoes, nous avons invité cinq personnes du public à être sur scène guidées par nous par télépathie. Je commence toujours par un désir, une idée abstraite qui veut trouver un corps, un faire. Pour moi, c’est lié à la danse. J’interroge d’autres disciplines, savoirs, choses et personnes. Non pas parce que je suis intéressé par la traduction de théories d’autres disciplines en danse, mais plutôt pour comprendre la phénoménologie de la question initiale. Et par curiosité. Au fur et à mesure des projets, j’ai pu aussi constater que la question du « bruit » était récurrente et avec du recul j’imagine que c’est peut-être lié à mes études en communication et en sémiotique. Phénomène sonico-physique, perturbation qui fait également partie de la communication, indistinction avant reconnaissance, quelque chose innommable donc ingouvernable, un arrière-plan d’où émerge le premier plan, un tiers, un parasite (comme décrit par Michel Serres) : le bruit semble être central. Il y a là une plasticité et une opacité qui m’intéressent.
Aujourd’hui, votre travail s’intéresse à l’esthétique et à l’éthique de l’intersection entre les arts vivants et les cultures vivantes. Pourriez-vous partager les grandes réflexions qui traversent cette recherche en particulier ?
À cette intersection, il y a des questions de goût et des questions d’écologie : la relation entre la contamination et l’immunité, la phénoménologie du dégoût et de la nausée, les idées d’enchevêtrement, d’hybridité et de domestication. Après avoir accouché, j’ai voulu continuer à travailler à la maison, en pensant avec et à partir du corps et non dans le studio de danse. La grossesse est une expérience qui modifie la compréhension du corps, de ses limites et, en général, le sens du « soi » : mon corps n’est pas seulement le mien, il peut être colonisé et dépend certainement d’autres corps. J’ai commencé à m’intéresser à différentes techniques de fermentation et à lire des livres liés aux éco-féminisme contemporaines, posthumanisme et néo-matérialisme (entre autres Donna Haraway, Paul B. Preciado, Elizabeth Povinelli, Elizabeth Wilson, Lynn Margulis, Anna Tsing, Deboleena Roy, Aimee Bahng, Jane Bennet). En tant que danseuse et artiste, je pouvais m’identifier à beaucoup de choses et je pouvais aussi voir ma pratique en relation avec mon environnement. Par exemple, lorsque nous parlons de « fermentation sauvage », différents aspects entrent en jeu : surveiller un processus ou en prendre soin sans le tuer, l’exploiter, créer les conditions pour que quelque chose se produise, le laisser faire sa propre chose. Il y a les figures de la « mère » dans le levain ou le scoby de kombucha (traduit en français, l’acronyme scoby signifie Culture Symbiotique de Levures et de Bactéries, ndlr) qui pourraient être liées à la façon dont les pratiques de danse sont partagées et dont le changement passe à travers différents corps. Aujourd’hui, je m’intéresse aussi à d’autres questions, comme la durabilité dans les pratiques des arts du spectacle : qu’est-ce que cela signifie de maintenir une œuvre ou une pratique en vie ? Que signifierait la préservation ou la fermentation de cette œuvre/pratique ? Comment pouvons-nous rendre cette œuvre/pratique plus durable pour les artistes ?
Comment MOLD s’articule à cette recherche ? De quelles manières ce projet vient-il poursuivre et développer ces réflexions ?
En travaillant sur la fermentation, j’ai commencé à faire pousser des peaux de scoby de kombucha (ces cultures ont d’ailleurs servi à la création d’un harnais, réalisé en collaboration avec l’artiste Günbike Erdemir, ndlr). Le kombucha contient des probiotiques pour nos intestins mais a un aspect morbide qui ressemble à de la peau d’animal ou du parchemin. Il s’agit d’un organisme symbiotique constitué de bactéries et de levures avec une forte odeur sucrée et écoeurante. Le titre MOLD, est apparu assez tôt dans le processus car son double sens synthétise ces forces disparates et paradoxales qui m’intéressaient. Le mot anglais mold signifie à la fois moisissure et moule. D’une part, il désigne un mycélium ou un champignon : un réseau de fils qui se développe de manière apparemment incontrôlable, colonise, infecte et digère son environnement. D’autre part, il fait référence à un moulage, quelque chose utilisé pour réaliser une sculpture et exploiter une forme spécifique.
En lien avec cette recherche, vous avez initié une série d’ateliers en collaboration avec le far° durant la saison 2021-2022. Pourriez-vous retracer la genèse de MOLD ?
En 2021, assez tôt dans le processus, nous avons présenté une série de gestes sous le nom de MOLDING : un pique-nique inattendu, un défilé non annoncé, une distribution publique de gaufres, une collection de sacs à main sous vide et un texte écrit à quatre mains. Il s’agissait de jouer différentes situations, de rencontrer le public dans un parc (Live Arts Week X, Bologne), dans une église convertie en espace d’art (Extracity, Anvers) et dans un musée d’art contemporain (Wiels, Bruxelles). Je souhaitais présenter nos pratiques encore jeunes sans les considérer comme des « travaux en cours ». Entre-temps, j’ai commencé à m’intéresser aux champignons et j’ai souhaité ouvrir cette opportunité de recherche à d’autres personnes en organisant une école ouverte. Inspirés par les méthodes de travail du mycélium et des mycologues, nous avons organisé, en collaboration avec le Far°, trois événements sous le nom de Technologie des champignons. Ces ateliers ont été l’occasion d’aborder les forêts et le monde des champignons à travers les récits et les connaissances de quelques invités : un butineur local, un scientifique, une journaliste, un chaman et une cinéaste. Ce projet n’avait pas vocation à se retrouver dans MOLD mais était l’occasion de créer un groupe d’étude qui rendait possible des connexions inattendues, de me placer, moi et mon travail, dans un contexte différent. J’ai compris plus tard que le « mushrooming » était devenu une sorte de méthode de travail, qui n’était pas directement liée à une planification et un produit préétablis, un « fruit ». D’un côté, il y a le butinage, la cueillette, la recherche, une façon de regarder qui vous donne une posture corporelle spécifique : errer, sentir, chercher des signes, demander autour de soi, cartographier le territoire. De l’autre côté, il y a le « mushrooming », qui consiste à « devenir champignon » : se décomposer pour digérer, manger de l’intérieur, prospérer à partir de déchets ou de ce qui est disponible, travailler dans le sous-bois et fructifier de temps en temps, tenir compte des humeurs, des températures, des impulsions électriques.
La polysémie du mot mold a été l’un de vos axes de travail. Comment avez-vous abordé et mis en pratique cette double signification dans votre recherche ?
J’ai commencé à travailler à partir du mot mold en suivant ses différentes sémantiques. Sa polysémie m’inspirait une forme de chimère (dans la mythologie grecque, la chimère est généralement représentée sous la forme d’une créature ayant la tête et le poitrail d’un lion, le ventre d’une chèvre et la queue d’un serpent. En tant que figure métaphorique, elle est utilisée pour décrire tout ce qui est composé de parties disparates et perçu comme invraisemblable. En biologie, le chimérisme génétique est un organisme unique composé de cellules ayant deux ou plusieurs génotypes distincts) et mon attention s’est focalisé sur l’écart entre deux significations différentes : le contenant et le réseau. D’une part, le moule est un contenant qui donne forme à quelque chose, une forme négative qui demande à être remplie, une structure qui soutient et traverse le corps, une dimension de gouvernance qui peut agir à partir de forces matérielles et immatérielles. Le moule est la mère, la matrice qui peut générer des originaux et des copies de l’original. D’autre part, nous appelons moisissure un champignon qui constitue un réseau de connexions en produisant des spores. En ce sens, la moisissure peut être considérée comme un processus de contamination qui s’échappe, s’infiltre, comme un système cybernétique de relations qui implique des mécanismes de communication et de rétroaction. Une technologie aussi raffinée que sauvage, non cultivée et non gouvernable. Le moulage et la moisissure signifient former, sculpter, encadrer, diriger, façonner, contrôler, créer, couler, influencer et affecter. Nous pouvons transposer cette réflexion à la manière dont nous reproduisons les comportements sociaux, les habitudes personnelles ou même les manières de danser, tandis que l’expérience d’un « autre », le temps, le désir, le déplacement peuvent être des formes de contaminations. Ces termes ne sont pas contradictoires : le moulage et la contamination coexistent. Un moule, en tant que récipient, donne forme à un corps, mais il a également été moulé lui-même. Il est donc modelable. Un champignon relie différents corps, imite leurs silhouettes ou en jaillit. Il peut changer la direction de sa croissance en fonction de nouveaux apports. Le moulage et la moisissure impliquent la plasticité dans les deux cas. Après le harnais en peau de kombucha, j’ai produit d’autres peaux, sans savoir ce qu’elles deviendront. J’ai réalisé une ferme à kombucha durant une résidence au Wiels à Bruxelles et à Buda à Courtrai (Le Wiels et le Buda sont deux centres d’arts belges, ndlr). Là, j’ai commencé à faire des sculptures et des assemblages. Avec l’aide de Deborah Robbiano (la graphiste de ROT, ndr) qui étudie maintenant la « mycologie radicale » avec Peter McCoy, nous avons réalisé des sculptures avec du mycélium : elle fabriquait ces formes organiques remplies de foin inoculé et je les maintenais en vie dans l’atelier jusqu’à ce qu’elles fructifient. De nouvelles sculptures sont nées de leur mycélification commune. Exposer une sculpture organique au sommet d’un socle en ciment ou faire du bondage sur des champignons étaient des façons de créer des objets hybrides. Certaines de ces sculptures sont présentes dans MOLD.
Comment s’est organisée l’écriture de MOLD ? Pourriez-vous revenir sur le processus de création avec vos collaborateur·ice·s ?
J’ai fait dans un premier temps une résidence dans un théâtre pour conceptualiser un dispositif. Lorsqu’une moisissure pousse sur de la nourriture, elle se développe sous la forme d’une tache ronde. J’ai donc imaginé un espace immersif organisé du centre vers l’extérieur avec tous les éléments, les corps, les objets, qui s’y intègrent progressivement. Estelle Gaultier a ensuite développé cette idée en utilisant la lumière comme matériau, comme objet, système de chauffage, etc. Je souhaitais travailler une dramaturgie des températures. Dans les processus de fermentation, la température change en fonction du processus chimique en action. J’étais curieuse de voir comment la température pouvait être un assemblage de sensations tactiles et physiques, d’images visuelles, etc, par exemple en braquant un projecteur dans le dos du public et en diffusant une odeur de brûlé et danser jusqu’à transpirer. Dans un second temps, pendant ma résidence au Wiels pour MOLDING, le travail sculptural a commencé à prendre forme. J’ai utilisé du mycélium, du ciment, de l’époxy, de la nourriture, du kombucha, des matériaux de construction, du maquillage, etc. Nous avons donc commencé les répétitions de MOLD en 2022 avec déjà beaucoup de matériaux issues de MOLDING. Christophe Albertijn a composé la musique de MOLD et MOLDING en synthétisant, détruisant, brisant, des sons issus des différentes étapes de la création et des bruits que nous produisons sur scène. Sofie Durnez, avec qui nous avions fait des recherches sur les parfums et les odeurs pour le magazine ROT. Elle a développé différentes situations olfactives, comme un vent frais qui sent la piscine. Sofie a également réalisé les costumes à partir de techniques mixtes (blanchiment, rembourrage, peinture sur lycra) avec comme références les sculptures de mycélium. Je me suis intéressé à la façon dont chaque élément pouvait affecter l’autre, y compris sur le plan synesthésique (Trouble de la perception sensorielle dans lequel une sensation normale s’accompagne automatiquement d’une sensation complémentaire simultanée dans une région du corps différente de celle où se produit l’excitation ou dans un domaine sensoriel différent, ndlr), à la façon dont le public allait être impliqué dans la dramaturgie de la performance, comment tous ces éléments à priori hétéroclites pouvaient s’articuler et créer du sens.
Avez-vous développé des outils de composition, d’écriture, spécifiquement pour cette nouvelle recherche ?
Durant le processus de MOLDING, j’ai proposé aux danseur·euse·s deux pratiques de mouvements qui peuvent rappeler celles d’un pique-nique et d’un défilé de mode. L’idée du pique-nique est venue d’un état d’esprit opposé à celui du défilé : une manière détendue, désengagée, moins spectaculaire de porter le corps, une vue panoramique, un tableau, sans compter que je travaille souvent avec de la nourriture. D’autre part, je m’intéresse à l’espace-temps conçu par un défilé de mode : un passage, en perpétuel changement, un espace restreint donnant une perspective rapprochée qui est à la fois non frontale et non narrative. Mes deux partenaires Marcos Simoes et Gitte Hendrikx ont incarné et enrichi mes propositions initiales, en les interrogeant avec des réflexions issues de leur expérience de ces deux pratiques. Jaime Llopis, qui a collaboré sur ce projet en tant que dramaturge, m’a également aidé à définir et creuser les différentes réflexions en jeu dans cette recherche. Lorsque nous avons commencé le processus de création de MOLD en 2022, j’ai réintroduit le pique-nique et le défilé comme principe d’expérimentation pour trouver des textures de corps et composer de nouvelles situations à partir d’assemblages et de déclinaisons. On a ensuite travaillé avec, contre ou au côté des objets et sculptures pour écrire des danses : il s’agit pour nous d’affecter et d’être affecté. Au fur et à mesure, les gestes sont tissés, se transposent d’un corps à l’autre, les objets se substituent et s’accumulent en installations dans l’espace. J’ai imaginé une chorégraphie où nous sommes à la fois seuls et ensemble : nous sommes liés par asynchronicité, nous nous déplaçons à partir de différents centres, comme les engrenages d’une machine, comme des moisissures qui se développent. Tout au long de la pièce, nous composons et nous décomposons, nous faisons et défaisons. Pour travailler le corps dans cette intersection entre les arts vivants et les cultures vivantes, je me suis intéressé à la figure de la chimère en biologie, en anthropologie, en archéologie (cf les travaux de Lynn Margulis, Elizabeth Povinelli and Mihnea Mircan). La Chimère incarne pour moi cette énigme de l’hybridité du corps : à la fois matériel, immatériel, synthétique, organique, mécanique, composite, etc. Elle est une façon d’aborder le corps du·de la danseur·euse comme un corps qui incarne différentes logiques incommensurables. La consigne n’est pas de danser « comme des chimères » : nous accueillons simplement ces questions et les oublions. Nous travaillons avec le corps comme un paradoxe. La danse devient une charnière entre le soin et l’ingouvernabilité : faire la danse et laisser la danse faire. Ce travail pour le·la danseur·euse, consiste à déplacer l’attention, pour déconstruire et reconstruire, en sachant que tout est déjà là et que tout est en mouvement.